Marcher dans les rues de La Havane réserve parfois des surprises inattendues. Juste derrière un vieux mur décrépi, une parcelle de verdure s’étale à perte de vue. Aucun tracteur ronronnant, aucun sac d’engrais chimique griffonné de marques internationales : ici, c’est le règne de l’organopónico, la ferme urbaine 100 % biologique qui transforme peu à peu le visage du secteur agricole cubain. Entre crise chronique, inventivité et résilience, comment ces îlots verts défient-ils la pénurie alimentaire et d’intrants ? C’est tout un pan caché du pays que révèlent les rencontres avec agriculteurs urbains et coopératives, chaque recette locale relevant d’un défi aussi bien économique qu’écologique.
Un contexte marqué par la pénurie et l’embargo
À Cuba, la productivité agricole a longtemps dépendu de méthodes conventionnelles et d’une importante dépendance aux importations de produits chimiques et machines agricoles. Or, l’effondrement du bloc soviétique au début des années 90 a brutalement coupé cette manne. Pendant cette « période spéciale », la pénurie alimentaire et d’intrants est devenue criante, précipitant le pays dans une véritable crise. Les étals se sont raréfiés sur les marchés, poussant les Cubains à revisiter entièrement leur manière de cultiver la terre.
L’impact de l’embargo américain, en vigueur depuis des décennies, complique encore la donne. Non seulement le pays manque de devises pour acheter denrées et matériels à l’étranger, mais il doit aussi composer avec une raréfaction extrême des produits phytosanitaires et des carburants. Dans ce contexte contraint, chaque kilogramme récolté relève presque de l’acte militant face à une crise agricole persistante.
Les organisations locales face à la crise alimentaire
Face à la récurrence de l’insécurité alimentaire, les autorités cubaines ont très tôt encouragé des solutions endogènes. Visiter un organopónico, c’est plonger au cœur d’une alternative née de la nécessité. Des maraîchers investissent des espaces urbains délaissés pour y produire tomate, salade, herbes aromatiques, haricots noirs et autres aliments essentiels. Tout cela grâce à une association subtile de connaissances anciennes et d’innovations techniques accessibles.
Les coopératives agricoles jouent également un rôle clé dans l’organisation de la production locale. Plutôt que de fonctionner comme des exploitations isolées, bon nombre d’agriculteurs cubains font front ensemble, mutualisant outils, semences et savoir-faire. Selon les saisons, ils partagent la production et mettent en place des stratégies collectives pour faire face à la variabilité météo ou à une nouvelle rupture d’approvisionnement. L’esprit de solidarité prime souvent sur la quête individuelle de rendement, à l’image de l’accompagnement proposé par Nomadays Cuba pour mieux comprendre les rouages de l’agriculture locale.
Des solutions locales, créatives et économiques
Pour pallier le manque d’engrais minéraux et de pesticides de synthèse, les Cubains recourent largement à des amendements naturels : composts maison, purins fermentés, voire déchets organiques récupérés auprès des habitants du quartier. Traction animale plutôt que motorisée, resemis manuel, irrigation goutte à goutte bricolée à partir de récupérations, toute une panoplie de méthodes agricoles alternatives s’épanouit dans les campagnes et jusque dans les villes.
Cette dynamique n’a rien d’anecdotique. D’après certains observateurs internationaux, près de 15 % des aliments consommés à La Havane sortiraient aujourd’hui des terres urbaines. En goûtant une tomate fraîchement cueillie dans un organopónico, on découvre d’ailleurs un produit naturellement savoureux, peu manipulé, et qui n’a pas subi des milliers de kilomètres en conteneur frigorifique.
Le quotidien des agriculteurs urbains
Ceux qui travaillent dans l’agriculture urbaine ne ménagent pas leurs efforts. Au lever du soleil, rakeltas à la main, ils binent, désherbent et sèment sous une chaleur souvent accablante. Certains racontent leur parcours : ancien médecin reconverti après la fermeture d’un hôpital, professeur lassé des salles de classe bondées, retraité trouvant là un nouveau souffle social. Pour eux, cultiver en ville, c’est autant subvenir à ses propres besoins que participer activement à la sécurité alimentaire du quartier.
Dans les échanges réguliers avec leurs clients – voisins, restaurateurs, écoles –, ces jardiniers citadins recueillent avis et encouragements. Ils observent les attentes grandissantes vers plus de qualité et de traçabilité. Chacun met fièrement en avant sa méthode écologique, insistant sur l’absence totale d’insecticides industriels dans les fruits et légumes proposés à la vente directe.
La transition agroécologique comme modèle de résilience
Si Cuba apparaît aujourd’hui comme un laboratoire mondial de l’agroécologie, c’est que sa transition ne procède ni de la mode, ni d’une vision idéologique isolée. Elle répond d’abord aux impératifs concrets de souveraineté alimentaire et d’économie circulaire imposés par le blocus. Le recours systématique à l’agriculture biologique découle d’une double rationalité : gagner en autonomie et préserver la fertilité des sols pour les générations futures.
Nombreuses sont les fermes et potagers collectifs à pratiquer la rotation stricte des cultures, l’association intelligente des plantes ou la multiplication de haies arbustives – autant de gestes inspirés par l’observation attentive des équilibres naturels. Là où la monoculture intensive appauvrit vite les ressources, les Cubains misent sur des systèmes résiliants, adaptés au climat tropical et aux contraintes matérielles du quotidien.
Une productivité agricole repensée
Malgré la difficulté à produire en quantité égale à certaines puissances exportatrices, la productivité agricole cubaine surprend par son efficacité sur de petites surfaces. Grâce à la diversification, chaque rang de blettes, betteraves ou aubergines contribue à maintenir un écosystème vivant et sain, réduisant ainsi les risques liés aux maladies ou aux ravageurs particuliers.
Chaque récolte devient objet d’échange et d’apprentissage. Loin de rechercher l’export massif, les producteurs locaux privilégient l’autoconsommation, la livraison à des marchés communautaires et l’alimentation des écoles environnantes. Une organisation centrée sur l’humain plus que sur la performance mécanique, redonnant sens au concept même de résilience agricole.
L’expérience gustative de la production bio cubaine
Goûter aux produits frais cultivés selon des principes biologiques procure bien plus qu’une simple satisfaction gastronomique. Les visiteurs rapportent la saveur authentique des carottes arrachées le matin même, la douceur acidulée des bananes plantain, l’arôme puissant des herbes aromatiques offertes en bouquet dans la main du cultivateur.
Des chefs reconnus dans la cuisine cubaine contemporaine intègrent désormais des ingrédients issus directement de l’agriculture urbaine. Ces produits trouvent légitimement leur place dans les assiettes les plus traditionnelles comme dans les créations culinaires innovantes, portés par la recherche d’excellence gustative et le besoin urgent de garantir la santé collective.
- Diversification des cultures pour lutter contre la monoculture et les parasites.
- Utilisation de composts et d’amendements naturels afin de remplacer les engrais chimiques importés.
- Recours aux méthodes biologiques pour assurer la sécurité alimentaire sans impact toxique.
- Soutien collectif via les coopératives, partage des ressources et esprit d’entraide.
- Mise en valeur des produits locaux auprès des habitants, des écoles et des restaurants.
Défis actuels et perspectives pour l’agriculture cubaine
Une visite auprès des agriculteurs laisse percevoir une préoccupation omniprésente : l’avenir du secteur agricole reste suspendu entre incertitude et espoir. Malgré des succès indéniables dans la transition agroécologique, la question de la sécurité alimentaire demeure sensible, notamment lors des périodes de sécheresse prolongée ou devant des barrières administratives persistantes.
La jeunesse rurale hésite encore à reprendre le flambeau familial, tandis que beaucoup préfèrent tenter leur chance ailleurs. Maintenir l’attractivité de l’agriculture ne va pas de soi : la modernisation limitée, les salaires modestes et l’accès réduit aux innovations technologiques freinent parfois les carrières agricoles. Pourtant, les success stories rencontrées parmi les coopératives prouvent qu’en conjuguant inventivité et solidarité locale, le modèle cubain continue à inspirer d’autres nations confrontées à la menace d’une crise agricole.
L’inspiration d’un modèle contraint mais innovant
Par la contrainte puis par conviction, Cuba a fait émerger un modèle d’agriculture durable reconnu sur la scène internationale. Ni utopique, ni figé, il propose des réponses crédibles à l’instabilité croissante des chaînes d’approvisionnement mondiales.
Les visiteurs repartent souvent marqués par l’humanité et l’ouverture des acteurs locaux. Cette expérience invite surtout à réinterroger nos propres habitudes alimentaires et nos choix de consommation, alors que les enjeux de la sécurité alimentaire deviennent universels.
Explorer davantage les fermes urbaines et leur savoir-faire
Retourner dans un organopónico, c’est comprendre que chaque carré de terre témoigne du courage d’un peuple sujet à la pénurie alimentaire et d’intrants, capable de transformer cet handicap en moteur d’innovation.
La multiplication de ces initiatives reflète le dynamisme d’une société qui progresse entre pénurie structurelle et créativité populaire. Naviguer entre l’histoire complexe de l’embargo et la jeunesse enthousiaste des agriculteurs des villes permet de saisir la véritable richesse du secteur agricole cubain, vécu jour après jour parmi l’éveil des papilles et la fierté renouvelée des producteurs.









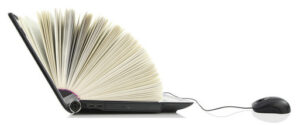













Commentaires